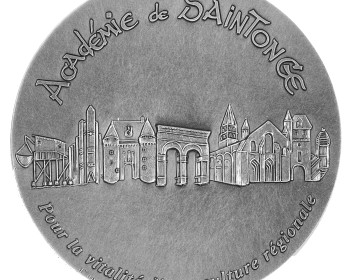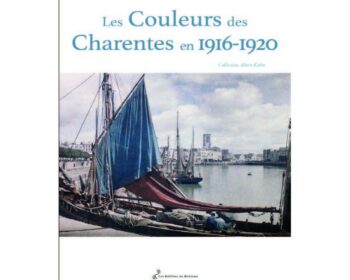Panorama de la vie culturelle Saintongeaise en 1999
Séance publique annuelle du dimanche 26 septembre 1999 (Château de La Rochecourbon).
Par François Julien-Labruyère, directeur en exercice.
Il me revient l’honneur d’ouvrir officiellement cette séance publique de l’Académie de Saintonge. C’est la quarante-quatrième fois qu’une telle séance est tenue, autant dire que j’aurais à coeur de respecter les traditions ; c’est aussi la quatrième fois que nous nous retrouvons à La Roche-Courbon pour célébrer cette journée de l’identité saintongeaise : je voudrais donc, avant toute autre chose, que nous remercions notre hôte, Jacques Badois, pour nous recevoir avec toujours autant de gentillesse… et autant de charme dans ce théâtre et ces jardins.
J’évoquais à l’instant nos traditions, établies principalement par François de Chasseloup-Laubat durant sa direction des années 1963 à 1965, et respectées depuis par tous ses successeurs. Il en est une qui consiste pour le directeur en exercice à rappeler les contributions de ses collègues en matière de culture régionale. Comme il en est une autre qui consiste pour le même directeur à ne jamais respecter son temps de parole, nous avons décidé, d’un commun accord, de supprimer ce morceau d’anthologie qui sous prétexte de nous justifier pouvait paraître suffisant. Ne croyez pas pour autant que nous soyons devenus d’une modestie à toute épreuve, les contributions de vos académiciens figurent en bonne place dans la petite brochure qui vous a été remise à l’entrée.
En revanche, je manquerais à mes devoirs de tradition, et en l’occurrence de respect, si je n’évoquais pas la figure de Louis Desgraves qui nous a quittés en début d’année. Jean Glénisson, son ancien condisciple, et Jean Flouret représentaient l’Académie lors de ses obsèques. On ne dira jamais assez l’apport de rigueur intellectuelle et de profonde intimité avec tout ce qui fait notre sentiment régional que représentait pour nous Louis Desgraves. Il était l’académicien le plus ancien, élu en 1960 au onzième siège à la succession d’Hector Talvart, et comme vous vous en doutez, il nous éclairait souvent par sa connaissance érudite du monde du livre. Jusqu’au dernier moment, il demeura très attaché à notre assemblée, participant à nos travaux avec une ardeur et une amitié exemplaires. Tout à l’heure, nous décernerons notre Grand Prix pour récompenser une action de vingt ans en faveur de la diffusion de la lecture publique en milieu rural, je suis sûr que cette initiative aurait beaucoup plu à l’ancien inspecteur général des bibliothèques qu’était Louis Desgraves. Je vous prie d’observer une minute de silence en son souvenir.
L’année dernière, au moment même où nous tenions notre séance publique, commençait à s’amplifier une polémique littéraire de première grandeur dont raffolent les milieux culturels parisiens. Au centre dû typhon, un roman… Il est de Michel Houellebecq, il s’appelle Les particules élémentaires, il fut surtout le best-seller de l’automne 1998 avec près de 250 000 exemplaires vendus. Si je l’évoque aujourd’hui devant vous, ce n’est pas pour disserter de son misérabilisme sexuel ou pour tenter de savoir s’il annonce, comme on l’a dit, une nouvelle école romanesque, celle du « déprimisme », c’est tout simplement parce que la partie la plus visible et la plus discutée de son roman se passe à quelques kilomètres d’ici, à Meschers, dans un camping au nom très postsoixante-huitard, L’Espace du possible, ce qui a d’ailleurs valu un procès à l’auteur. Je ne vous raconterai pas les méandres particulièrement salaces, pour ne pas dire franchement nauséeux, qui trament le séjour du narrateur à Meschers, je ne laisserai pas non plus supposer que notre Académie a, ne serait-ce qu’un instant, envisagé de donner une récompense à ce roman, je souhaite seulement profiter de la polémique pour réfléchir à ce que pourrait être son écho dans la région. On sait qu’une des facettes les plus fécondes du régionalisme consiste justement à se saisir d’événements notables et lointains pour les rattacher, les intégrer, à l’identité locale. Qu’en, sera-t-il des Particules élémentaires ? Donneront-elles à Meschers une part de son image, dans le genre new age dégénéré, seront-elles un jour transformées en une légende de « belle époque », en symbole local des débuts de la civilisation du « sea, sun and sex » ou tout simplement en goût de soufre ? Je l’ignore, mais je suis à peu près certain, surtout si le succès du roman se confirme et devient synonyme de mal de notre siècle, de déprime de notre temps, que Meschers saura s’en emparer pour démontrer son importance. L’identité est toujours habile à se servir de tous les matériaux qui lui tombent sous la main, même s’ils sont d’origine douteuse.
Tout le monde connaît les grottes de Matata, elles assurent une partie de la notoriété de Meschers. Un sorcier, pêcheur de crevettes et fabricant de galoches, aurait vécu là, en troglodyte et ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’on se serait aperçu que sous le nom de Matata se cachait le page Belcastel, ancien amant de Charlotte de La Trémoille, princesse de Condé, accusée d’avoir assassiné le prince à Saint-Jean-d’Angély. En fait, l’histoire est totalement falsifiée : en 1932, un livre fort documenté de René La Bruyère sort le nom de Belcastel de l’anonymat complet dans lequel il se trouve, en récusant d’ailleurs toute idée d’assassinat du prince de Condé. Trois ans plus tard, Paul Dyvome, un touche-à-tout joliment j’entre-en-ville, percepteur de son état, à Royan, publie un petit livre de contes et légendes sous le titre de Folklore saintongeais ; une des nouvelles s’appelle « Matata le sorcier« , il l’écrit en déformant la réalité historique, pour faire un peu de publicité à son ami qui, durant la belle saison, tient un restaurant dans les grottes ! Depuis, l’histoire de Matata semble authentique et immémoriale ; prétendre le contraire, comme je le fais en ce moment, serait faire preuve de mauvais esprit saintongeais !
Les affaires de ce genre sont légion en matière d’identité régionale. Soit comme trucage historique pur et simple, soit comme renversement dans la signification. Par exemple, cette fiction, encore une fois conçue par Dyvorne, du personnage mythique de Blanche de La Chapelaine qui aurait créé le système des écaillères de Seudre… Ou encore celle du célèbrissime grenadier Nicolas Chauvin, qui a donné son nom au chauvinisme et dont Rochefort se glorifie d’avoir été le berceau… Il est maintenant prouvé que ni Blanche de La Chapelaine, ni Nicolas Chauvin n’ont existé. La première provient de la pure imagination de Dyvorne, le second d’un canular monté par un de ses étudiants au vieil Arago. Et pourtant la fortune identitaire des deux personnages, localement pour l’écaillère, internationalement pour le grenadier de la Grande Armée, leur assure une réalité historique qu’on a du mal à mettre en cause. Le brave Nicolas possède sa rue à Rochefort comme un héros réel de l’Empire, la bonne Blanche continue de symboliser le bassin de Seudre dans tous les livres érudits le concernant.
Plus subtiles sont les évolutions de sens. Prenons la rose trémière : elle est aujourd’hui le décor dominant de nos villages côtiers, alors qu’autrefois elle était considérée comme une mauvaise herbe dont on se méfiait parce qu’elle envahit les plates-bandes ; on la laissait pousser dans les fossés ou au fond des poulaillers pour ses vertus en décoction, lorsqu’on s’était mâché un muscle. Je suis sûr que son côté fleur paysanne, vaguement méprisée si on la compare aux roses des vrais jardiniers ou aux dahlias des parterres bourgeois, a plu à cette part de notre sensibilité affirmée en 1968 et qui s’appelle le retour à la nature. La passerose, c’est notre fibre hippie, notre emblème écolo… Qui plus est, bien pratique pour ces maisons d’absence que sont les résidences secondaires car elle pousse toute seule et elle est une fleur pérenne. Autre exemple, celui du carrelet lorsque dans les premières années du siècle, il se mit à pulluler en équipements fixes sur nos rochers, nombreux furent ceux qui le déplorèrent ; on les considère de nos jours comme partie intégrante de notre patrimoine et comme un des signes distinctifs de nos côtes. On se souvient de la protestation qui s’est emparée de la région, il y a cinq ans, lorsqu’une mise à niveau des règlements maritimes a voulu les supprimer…
Ceci est également vrai pour les cabanes ostréicoles ; peintes de goudron, elles font aujourd’hui partie de notre paysage mental et on fait tout pour les sauver, même si elles sont économiquement et socialement dépassées, et que la seule façon d’y parvenir est de les louer à des estivants qui les transforment en ateliers d’artistes, repeints de couleurs vives, ce qui les fait ressembler à des miniatures de maisons scandinaves. N’oublions pas qu’au début du siècle, on les considérait comme des verrues envahissant les chenaux de nos marais. On est donc passé par trois phases : les cabanes sont d’abord rejetées au nom du respect de l’esthétique, elles correspondent alors à la norme économique du moment ; ensuite, on s’y habitue, en même temps que leur utilité économique se voit mise à mal par de nouvelles réglementations, notamment d’hygiène sanitaire ; au moment où on les abandonne pour de justes raisons professionnelles, un mouvement de défense de la tradition tente de les sauver en changeant leur vocation. Et ceci, toujours au nom de l’esthétique. Au début du siècle, une cabane était laide et défigurait nos marais ; on la considère maintenant comme pleine de charme et donnant son caractère au même marais ! Hier, elle abîmait le paysage, aujourd’hui sa disparition abîme l’identité, c’est-à-dire le paysage habillé d’une activité et d’une histoire. On peut parfaitement imaginer que demain, les cabanes goudronnées, seulement goudronnées, seront mises à l’index comme défiant l’esthétique colorée des autres cabanes…
Le processus de folklorisation sera alors total.
Où donc se situe la vérité identitaire de nos chenaux ? Dans la conservation d’un état de paysage qui correspond à une époque révolue et tend à se déconnecter peu à peu de l’activité qui l’a vu naître ? Ou dans l’idée qu’une identité est forcément liée à un équilibre économique ? On le sent bien, aucune des branches de l’alternative n’est en soi satisfaisante. Et personne ne possède vraiment la réponse. Si j’ai engagé cette réflexion avec vous, devant vous, plutôt que d’établir un panorama factuel de notre culture régionale, comme il est de tradition en cette occasion, c’est parce que se pose là, structurellement, audelà de l’événement, la problématique de fond de notre identité et de ses manifestations. Pour nous, Académie de Saintonge dont la fonction est de distinguer ce qui, justement, contribue à cette identité, on voit bien la difficulté de saisir les permanences de l’attachement et de ne pas se laisser entraîner aux effets de mode. Autrement dit, qu’aurait-il été souhaitable pour notre Académie ? Primer le livre d’histoire de René La Bruyère ou la belle légende inventée par Paul Dyvome ? Saluer les efforts de Bourcefranc à moderniser son outil de production ou ceux de La Tremblade à folkloriser ses cabanes ostréicoles ? Et dans le cas d’un acquiescement à cette fabrication d’identité, à quel stade le signaler ? Le faire au tout début d’une folklorisation serait prendre le risque de l’avorton ; le faire en pleine ambiguité de son développement serait forcément critiquable, et critiqué des deux côtés ; quant à le faire en fin de cycle, cela virerait au cliché !
Ne rien faire, diront les sages ; prendre des risques, soutiendront les autres… Il est certain qu’il est plus facile pour un organisme comme le nôtre de signaler de l’apparemment sérieux, du bien assis. Pourtant, ne concluons pas trop vite. Le processus de folklorisation, et je lui assimile toute forme d’expression esthétique ou imaginaire, peut devenir à lui seul une source de sérieux, au sens où l’identité se nourrit aussi de babioles, de balivernes, éventuellement approximées ou même carrément frelatées. Que serait la réussite balnéaire de la Charente-Maritime sans cette sorte d’appui compensatoire que représente notre identité locale ? Les cabanes ostréicoles de La Tremblade, les passeroses de Talmont, le personnage de Blanche de La Chapelaine, les légendes entretenues autour des grottes de Meschers ou encore les aquarelles qui en deviennent de plus en plus le média privilégié, tout cela concourt à justifier le choix de nos côtes comme lieu de vacances. Il y a quelques années, les estivants disaient qu’ils ne souhaitaient pas « bronzer idiot ». Vu du côté charentais, du côté de celui qui reçoit, il s’agit tout simplement d’un accompagnement de la politique balnéaire par l’identité locale.
Je sais bien qu’en affirmant cela, qu’en instrumentalisant ainsi notre culture et notre identité régionales au service de la fréquentation estivale de nos côtes, au service donc d’une activité économique première dans notre département, je vais en choquer certains. J’aurais pu prendre d’autres exemples, ils relèvent tous de la même logique. Quand le catamaran Charente-Maritime gagne une transat, ce qui n’est après tout qu’une pure opération identitaire, cela profite à l’ensemble de l’activité économique du département et en tout premier lieu au bassin d’emploi de La Rochelle pour ses retombées dans le secteur du nautisme. Quand les mouettes s’emparent des pare-brise de nos voitures ou quand Fort Boyard se transforme en studio de télévision, l’un et l’autre avec le succès qu’on connaît, c’est l’image du département qui se voit valorisée, et on sait à quel point le monde d’aujourd’hui est sensible à ces phénomènes de médiatisation. Il suffit de parcourir les rayons d’un supermarché pour se rendre compte, à quel point Boyard est devenu présent sur les étiquettes des produits charentais, pineau en tête. Hier, y dominaient les églises romanes, avant-hier les coiffes régionales, avec une prime à la fameuse quichenotte dont chacun sait que son étymologie de « kiss not’ est une fantaisie inventée par Pierre Jônain lors de sa période royannaise… Comme quoi, le balnéaire aime la fable, kiss mot, Matata ou les clefs de Boyard, et la région se plaît à ces rigourdaines. Sans en être vraiment dupe, mais pour certains en en étant totalement dupe…
Ce n’est pas pour autant que l’Académie de Saintonge doive décerner une médaille au Père Fouras, ce sphinx des énigmes qui ouvre les portes du trésor de Fort Boyard. Il existe différents niveaux d’expression de notre identité régionale : le grand raout médiatique figure la base de la pyramide, la thèse confidentielle sur tel ou tel aspect de notre histoire son sommet. Notre rôle est également un rôle de médiateur, il est de savoir sélectionner pour signaler ce qui en a le plus besoin, tout en étant conscient qu’il s’agit là d’un tout et qu’à la longue, il peut survenir des retournements de sens où, en termes d’attachement, le futile et l’apparemment inutile l’emportent sur le sérieux. Rassurez-vous, rien n’est plus sérieux que notre palmarès de cette année. Tout simplement, avec ses gabares, ses alambics, sa Route des trésors ou son univers fantasmé par Loti, il incite, probablement plus que d’autres, à ces réflexions autour de notre identité.