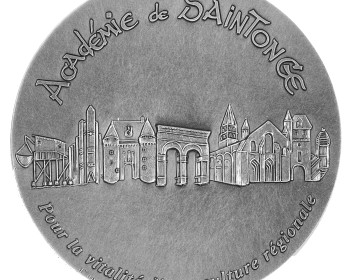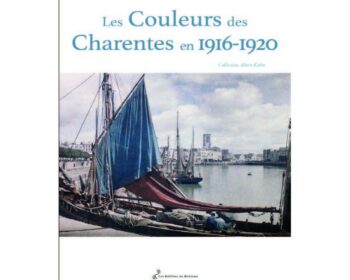Réception de Violaine Massenet
 13ème siège, quatrième titulaire.
13ème siège, quatrième titulaire.
Romancière (Portd’Envaux 1951 – ). Apparentée à la famille des Brejon, nièce de Jacques Brejon de Lavergnée, son enfance est enracinée en Saintonge, plus particulièrement à la Prévôté de Port-d’Envaux. Elle enseigne le droit administratif et la sociologie politique à la faculté Jean Monnet de Sceaux (Paris Xl) et anime des ateliers d’écriture. Elle publie Les Familiers de l’ange (Julliard, 1990) ; La Désaccordée (Julliard, 1991) ; Le Voile (Gallimard, 1992; prix du roman décerné par l’Académie de Saintonge) ; La Part du sable (Denoël, 1994) ; Le Sang des ruches (Denoël, 1996) ; Frère de sang (curieux roman matricide à La Différence, 1999) ; Blanche de Saintonge (roman historique chez Flammarion, 2002). La critique est toujours élogieuse à son propos. On lui doit également deux biographies, celle d’Alain-Fournier* (Flammarion, 2005) et celle de François Mauriac (Flammarion, 2000). Pas plus que l’écrivain bordelais, Violaine Massenet ne se libèrera jamais de son enfance. Pour le plus grand bonheur des Charentais. En 2004, elle est élue membre de l’Académie de Saintonge. Son discours de réception est consacré à comment la Saintonge peut éveiller la vocation d’un écrivain. Elle y affirme que ses deux maîtres en littérature furent son oncle, Dominique Brejon de Lavergnée, et son cousin, Vincent Regnauld de la Soudière (d’après la notice établie par Henri Texier). Membre de l’Académie depuis 2005.
Réception de Violaine Massenet par Madeleine Chapsal
Violaine Massenet est née un 22 juillet. Le sort veut que ce soit le jour de la sainte Madeleine, ma protectrice !
Déjà, pour cette aimable coïncidence, je suis heureuse de recevoir Violaine Massenet à l’Académie de Saintonge et d’avoir été chargée par notre Société de vous parler un peu d’elle.
D’autant que les bonheurs de la naissance ne s’arrêtent pas à ce faste 22 juillet : vous serez sûrement charmés, comme moi, vous qui êtes ici, les Charentais, les Saintongeais, de savoir que Violaine Massenet est née à Port-d’Envaux, dans le beau domaine familial de la Prévôté. Ainsi, avant même d’avoir ouvert la bouche – qu’elle n’a guère refermée depuis – et avant d’avoir pris la plume – qu’elle n’a plus lâchée… – Violaine nous appartenait déjà.
Toutefois, il a fallu la saisir, cette Saintongeaise, la rattraper par les basques car, dès sa jeunesse, cette jolie femme est d’emblée partie sur des routes lointaines, des chemins de traverse, des voies inédites, pour suivre ce qui fait entre autre notre singularité : la diaspora charentaise. Lisez ou relisez Les Grands Charentais publié par notre directeur François Julien-Labruyère dans sa prolifique maison du Croît vif et vous vous apercevrez que quantité de Charentais de grande comme de petite envergure, partent rapidement ailleurs se faire un nom, ou trouver fortune. Quitte à revenir sur les lieux de leur naissance et de leur petite enfance, pour y prendre leur retraite et s’y sentir plaisamment heureux.
Aussi, ne nous étonnons pas si dans un premier temps l’intérêt de la jeune Violaine Massenet la porte à étudier l’Égypte et aussi l’Europe. Esprit vif et studieux, elle se retrouve sans retard maître de conférence en droit public et en sociologie politique. Un choix qui indique sa passion à la fois pour l’enseignement et pour les grands mécanismes qui régissent la vie des sociétés et de leurs membres.
Est-ce l’aridité de ces sujets qui ne laissent guère de place au rêve ni à l’imagination, mais vers la quarantaine, Violaine se tourne avec force vers le roman.
Avec la fécondité qui est la sienne, c’est aussitôt le déferlement : Les Familiers de l’Ange, en 1990. L’année suivante : Les Désaccordés. En 1992, Le Voile. En 1994, La Part du Sable. Le Sang des ruches en 1996. Et l’œuvre écrite se poursuit jusqu’à aujourd’hui à ce même rythme accéléré : Frère de sang, en 1999, Blanche de Saintonge, en 2002. Cette avalanche ne suffit pas à notre passionnée : en parallèle paraissent ses brillantes biographies : François Mauriac, en l’an 2000, Alain-Fournier, tout récemment.
Il est notoire qu’en ce qui me concerne je publie assez fréquemment. Toutefois j’ai tendance à me limiter aux essais et aux romans, car la biographie demande un travail considérable : de multiples lectures, assorties de recherches approfondies, d’enquêtes en tout genre. Sans compter qu’il y a les familles, des ayants-droit, des aficionados de cet auteur que vous aurez entrepris de disséquer qui vous attendent au coin du bois, sur le qui-vive, prêts à vous demander des comptes, déjà sur chaque erreur de fait ou de date, s’il s’en trouve, mais aussi sur votre interprétation de leur grand homme et les détails nouveaux, les révélations inédites qu’au terme de vos investigations vous êtes à même de rendre publics.
La biographie s’avère par sa nature même une entreprise quasiment interminable, autant que périlleuse… Mais, si l’affaire est bien menée, le résultat en vaut hautement la peine : j’ai lu la biographie de Alain-Fournier, que Violaine Massenet nous offre cette année et, sans compter le plaisir que j’ai pris à cette lecture chargée d’émotion et même d’amour, j’y ai appris bien des choses sur ce jeune et bel auteur disparu à vingt-sept ans dans les premiers combats de la guerre de 1914.
Pourtant j’ai pu connaître madame Simone, la belle comédienne qui fut la dernière passion de l’auteur du Grand Meaulnes, lorsqu’elle appartenait encore au jury Femina dont je fais partie. Je l’ai même interviewée pour L’Express où je travaillais alors, et c’est une autre femme, dans tout l’éclat et la vivacité de sa prime jeunesse – madame Simone est morte centenaire – que j’ai découverte grâce au récit fouillé et ému de Violaine Massenet. Un remarquable travail de biographie que je compte signaler à mes consœurs du Femina, en vue de notre prix annuel.
Mais l’ouvrage de la Dame ne s’arrête pas là… Lorsque j’ai rencontré Violaine Massenet, pour mieux la connaître afin de vous en parler et de la présenter aujourd’hui, je lui ai tout de suite demandé : « Où trouvez-vous le temps d’écrire des livres si copieusement documentés ? » Je songeais également à Blanche de Saintonge, un roman historique situé au XIIIe siècle, fourmillant de notations et de détails si bien vus qu’en le lisant, on a envie de s’exclamer : « On s’y croirait ! »
À ma question, notre nouvelle et pétillante académicienne rétorque : « À vrai dire, je ne fais que ça ! J’anime des ateliers d’écriture en milieu carcéral et auprès des jeunes défavorisés des cités, un travail que je fais avec des psys lacaniens. Par ailleurs, je séjourne régulièrement au Mali où je collabore à la construction de Balafina, et… ». Et, là, c’est moi qui poursuit : Violaine Massenet a aussi sa famille, ses enfants, ses nombreux amis, elle s’attelle à faire la cuisine, à jardiner, et elle s’occupe de la vaste demeure de la Prévôté qui est l’un des joyaux de Saint-James, près de Port-d’Envaux.
Confrontés à une activité tellement intense et à une œuvre aussi variée, il est apparu comme évident, à l’Académie de Saintonge, que cette Saintongeaise de naissance avait sa place parmi nous. Reste qu’après le vote, il s’est avéré difficile de mettre la main sur notre nouveau membre afin de lui annoncer son élection : la Dame était une fois de plus ailleurs, occupée à enseigner, à écrire, mais surtout à vivre…
Aujourd’hui, nous avons la chance que Violaine Massenet ait accepté de se tenir un peu tranquille à nos côtés et de vous faire face. Toutefois, devinant qu’elle brûle de sa temporaire inactivité, je crois préférable de lui laisser la parole afin qu’elle vous dise elle-même les sentiments que lui procure son élection. Et ce qu’elle a projet de faire, car il ne saurait en être autrement avec elle, pour l’Académie de Saintonge et pour répondre aux attentes de son public. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, car pour vraiment savoir qui est Violaine Massenet, il ne suffit pas de la regarder, ce qui est un plaisir, il y a mieux encore : l’entendre parler.
A vous, Madame !
Comment rejoint-on la littérature ? par Violaine Massenet
Comment rejoint-on la littérature ? Parfois, c’est tout simple : il suffit de naître. Telle fut, en tout cas, mon expérience. Naître à la Prévôté, c’est venir au jour, par le plus précieux des hasards, dans une demeure qui dès la fin du XIVe siècle servit souvent de prison. La Prévôté de Saint-Saturnin-de-Séchaud apparaît pour la première fois en 1442 dans les textes : maison de passage pour les malfaiteurs conduits ensuite au prévôt de Saintes. Tours jumelles au toit plat incliné dans la riche lumière de l’été. Cadran solaire à l’angle oriental de la maison forte. Appareils de défense saillant aux angles : échauguettes et mâchicoulis défiant d’invisibles assaillants.
Dans un lieu clos, miraculeusement préservé des atteintes du temps, l’imaginaire règne en maître. Il rôde, hante les couloirs déserts, les chambres immenses et vides, les lits à baldaquins poudrés de poussière, les escaliers dont les marches usées creusent des échos à l’infini. Les fenêtres s’ouvrent sur des prairies et des bois. La pensée vagabonde, délaisse l’espace circonscrit par les pesanteurs de l’Histoire, s’élance vers la Charente jusqu’à la mer.
Enfant, j’échappais au rituel des vacances et je trouvais refuge dans une cabane en bordure d’un marais que le fleuve réveillait par instants. Je regardais des heures les sombres nasses à anguilles, j’essayais d’apprivoiser l’eau trompeuse, de surprendre les hérons au nid, je guettais le passage des grues et j’attendais qu’un renard se glisse dans les hautes herbes comme une flamme rapide et rusée.
Bien avant de savoir lire, je déchiffrais les multiples griffures, les signes écorchés du désarroi laissés ici et là par les captifs, gens de sac et de corde, voleurs de grands chemins, rebelles à l’ordre établi. Les marques inscrites au creux de la pierre de Crazannes me fascinaient. C’est grâce à elles que pour moi l’écriture a pris corps, ce sont ces traces de peur et de détresse qui m’ont initiée.
Pourquoi devenir écrivain sinon pour laisser, non à la postérité mais à l’imprévu d’une découverte, la singulière aventure d’être lu, par delà la mince frontière qui sépare les vivants et les morts ?
Maison de haute naissance, à jamais figée dans ses secrets, ses drames, ses déchirures. Maison de famille. Et quelle famille… Pas de celles que l’on hait, selon l’exclamation gidienne, mais de celles que l’on chérit d’un amour d’autant plus profond qu’il puise sa force dans l’inquiétude et la nostalgie.
Et cette famille est déjà une légende. La légende de Clémence Rogé, cousine de mon grand-père maternel, Fernand Brejon de Lavergnée. Héritière d’une lignée d’ombres, vierge mélancolique, victime d’un de ces chagrins d’amour dont on ne guérit pas, elle vécut à la Prévôté de très longues années dans un enfermement volontaire, avec pour uniques compagnons une servante dévouée et un âne très doux. Le seul à franchir la barrière d’orties et de silence qu’elle avait érigée pour protéger sa solitude, à passer le seuil de cette antique demeure à la dérive, fut ce grand-père. Un avocat de talent, assez chrétien pour défendre gratuitement les déshérités mais assez ferme dans ses convictions religieuses pour refuser de plaider les divorces.
Quand elle sentit venir sa fin, Clémence fit atteler sa pauvre charrette et se rendit au 3 de la rue Saint-Maur, à Saintes, où vivait mon grand-père et sa nombreuse famille. En mourant, elle légua la Prévôté à son cher cousin qui l’avait accueillie. Et c’est là, dans son bureau de la tour de l’Est que mon grand-père écrivit son livre de raison. Certes, il ne s’agit pas là de littérature au sens strict mais d’une mémoire vivante et vibrante, d’un pan vif du passé préservé des atteintes du temps. D’une chronique pudique et précise, pieusement rédigée au fil des heures dérobées au travail et aux charges familiales. Une rare sensibilité faisait souvent vibrer cette écriture serrée, dérobée aux multiples obligations d’un notable de province aussi exigeant avec lui-même qu’avec les siens.
Puis ce fut la découverte posthume de mon oncle, Dominique Brejon de Lavergnée, l’un des frères de ma mère, authentique écrivain lui, auteur d’un chef-d’œuvre Le Cœur anachronique, publié en 1943 aux éditions Gallimard, alors que son auteur avait rejoint les rangs gaullistes. Il avait ressenti très tôt l’appel d’une vocation irrésistible et, dès ce premier ouvrage d’un diptyque, Les Romanesques, dont il n’eut pas le temps de nous donner le second volume, Dominique se montre le digne héritier d’Eugène Fromentin et de Marcel Proust. Il fait le récit au scalpel d’un malentendu secret, d’une sourde blessure. Comme prisonnier d’un mauvais songe, le héros se trouve toujours éloigné de celle qu’il adore. Cette distance courtoise, au lieu d’entretenir sa flamme, débouche sur l’amertume de l’absence. Il se lance à la poursuite de l’être aimé sans jamais parvenir à l’approcher réellement. Et lorsque les obstacles accumulés comme à plaisir par la timidité, le respect des codes sociaux et la simple malchance, sont enfin aplanis et qu’il va lui être présenté, lorsqu’il s’apprête à lui révéler son nom et son amour, il apprend qu’elle est fiancée. L’image radieuse se change en icône torturante. Le Cœur anachronique est le roman de l’hésitation et de la défaite, de la disparition et de l’effacement, de l’élan amoureux et de la désillusion ; il a hanté mon adolescence et s’inscrit en creux dans mon premier roman, Les Familiers de l’ange, publié chez Julliard en janvier 1990. L’ange du titre, c’est d’ailleurs Dominique, figure centrale du livre.
Mais il y en eut d’autres pour m’entraîner sur ces étranges sentiers de la langue où les mots sont nos seuls guides et où, comme dans les marais de Saintonge, on a vite fait de s’égarer, de s’enliser faute de repères et de bornages.
Dominique avait une sœur, Marie, ma marraine, la préférée de ma mère Béatrice à laquelle la liait une profonde complicité, une affinité d’âme et de cœur. Et tout naturellement, ce fut lui que Marie choisit comme parrain de son premier fils. Ce cousin, Vincent de La Soudière, qui ôta la particule de son nom pour signer ses œuvres, fut mon second modèle. Lors de ma naissance, un soir de juillet caniculaire, à l’heure des hirondelles, il était aux côtés de sa mère et de la mienne, précoce enfant-poète de onze ans. Cet écrivain délicat, au sens fort du terme, rare et secret, raffiné et cruel, profond et subtil, fut mon maître en littérature. Auteur de déchirantes Chroniques antérieures qu’admirait Henri Michaux au point qu’il fit le frontispice du volume paru chez Fata Morgana, il disparut lui aussi, happé par les remous d’une époque dont il sentait monter la barbarie. Il se jeta dans la Seine un jour de mai 1993, cinq jours après le suicide de Pierre Bérégovoy qui l’avait bouleversé, comme il l’écrit dans sa dernière lettre.
Ainsi, c’est dans la maison et dans la famille de ma mère que s’enracine ma vocation d’écrivain. Mais il existe une autre source que je n’ai pas encore évoquée : la province saintongeaise. Si la Prévôté, avec ses habitants, spectres et vivants intimement mêlés, fut à l’origine de mon penchant coupable pour la fiction, la Saintonge m’inclina pour une part égale vers l’écriture. J’aime passionnément cette terre parce que la lumière y règne en maîtresse, parce que le ciel s’y ouvre et s’y déplie comme un grand livre blanc où les nuages s’inscrivent comme des phrases portées par le vent. Dérobé et transparent à la fois, cet étrange pays s’offre autant qu’il se préserve.
Je dois enfin rendre hommage à celui sans lequel aucun de mes livres n’aurait été écrit, mon mari, Pierre Lepère. Poète, essayiste, romancier, il a mis son immense talent à mon service, sachant parfois oublier son œuvre pour m’aider à créer la mienne. Il a été et demeure le passeur, plus proche de mon univers que nul autre. C’est grâce à lui que vous me faites l’honneur de me recevoir parmi vous aujourd’hui, ce dont je vous remercie du fond du cœur.
Ma dernière pensée sera pour mon oncle Jacques Brejon de Lavergnée, inlassable historien du droit, qui fut et continue d’être l’un des vôtres et, je peux le dire maintenant, l’un des nôtres. Je me réjouis d’être accueillie dans votre assemblée. J’espère me montrer digne de votre confiance. Ma gratitude va tout particulièrement à madame Madeleine Chapsal. Plus on connaît cette merveilleuse romancière des saisons extrêmes et des élans sauvages du cœur, plus on l’aime. Puissions-nous, mes chers collègues, partager encore de nombreuses joies, vivre de multiples émotions. Je vous remercie d’avoir bien voulu m’écouter.