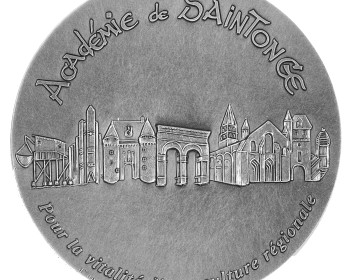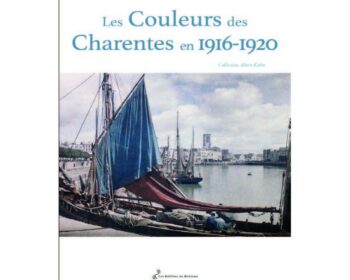L’art du récit à la télévision
Il m’a été confié la tâche périlleuse qui consiste à vous parler de la culture à la télévision. Deux mots que l’on a l’habitude de considérer comme antinomiques mais qui pourtant, cahin-caha, vont de pair, dans ma vie quotidienne professionnelle et dans celle des téléspectateurs que nous sommes, chacun d’entre nous, tour à tour.
Comme vous avez la grande gentillesse de m’accueillir au sein de votre Académie en raison de mes documentaires pour la télévision, je vous suis redevable de beaucoup. Et je ne pense pas m’acquitter de ma dette en vous faisant simplement part de ma modeste philosophie sur la question. J’ai donc appelé à la rescousse trois personnalités d’envergure : un aborigène, un philosophe et un Charentais.
Au mois de mars dernier, pour les besoins d’un film, je me trouvais au fin fond des forêts équatoriales du nord de l’Australie en compagnie d’un individu exceptionnel qui s’appelle David Gulpilil. Gulpilil qui est aborigène a découvert (ou a été découvert par) la civilisation occidentale lorsque, à dix-sept ans, il a été engagé pour tourner un rôle dans un film. À l’époque, il ne parlait pas anglais et communiquait par gestes avec son metteur en scène. Aujourd’hui, Gulpilil est une star du cinéma primée à Cannes ou à Venise, mais entre deux tournages, il regagne son village de la forêt vierge, pour vivre exactement comme le faisaient ses ancêtres. Il m’a invitée à lui rendre visite en pleine saison de cyclones, mais comme je m’aperçois qu’aucun de vous n’a apporté de sac de couchage ni de nourriture pour plusieurs jours, je ne vous raconterai pas mes aventures là-bas et je m’en tiendrai à l’essentiel de mon propos.
Gulpilil donc pense que le rôle fondamental qui nous est imparti est de transmettre ce qu’on nous a enseigné, et il ne parle pas des compétences mais, pour reprendre sa formule, de quelque chose de beaucoup plus important : les histoires de la connaissance. J’aime beaucoup sa phrase : « Si on ne raconte plus les histoires, si on ne les écoute plus, alors la culture disparaît, comme un guerrier qui se couche pour mourir ». De génération en génération, les aînés doivent révéler les récits aux jeunes. « Plus on est vieux, plus on sage, plus on est important. Dans votre société, vous cachez votre âge, qu’est-ce que c’est que ce bazar ? »
Son village est loin de tout et manque de beaucoup de choses, mais pas de talents. Et Gulpilil m’a montré les tableaux de son peuple, ces merveilleuses peintures aborigènes qui, pour nous, sont des œuvres d’art et qui, pour eux, rassemblent l’univers car elles « racontent l’histoire de nos ancêtres depuis le temps du rêve. Elles expliquent ce que nous sommes et chaque parcelle de nos terres, ce sont nos dix commandements ». Lévi-Strauss disait que, par rapport sans doute à d’autres peuples qu’il connaissait, les aborigènes étaient des snobs. Moi, je trouve que ce sont des snobs bien sympathiques. Car en somme, ce qui donne un sens à la vie de Gulpilil, ce sont des histoires et des images…
Cette rencontre m’a marquée. À tel point que, de retour en France, j’ai arrêté ma voiture, sur le bord de la route, pour mieux écouter une émission de France Culture dans laquelle un philosophe (j’ai malheureusement oublié son nom) convoquait le ban et l’arrière-ban de la pensée contemporaine depuis Nietzsche pour expliquer l’importance du récit dans la construction de la personnalité. C’était passionnant et ce monsieur aurait pu être nommé aborigène honoris causa. La personnalité, soulignait-il, se structure par le récit. Et ceci, dès le plus jeune âge. Les récits que l’on fait à un enfant, qu’il s’agisse de la Bible, du Coran, du Petit Prince ou du Chaperon rouge sont indispensables à sa formation, à l’élaboration de son univers intérieur. Mais il ajoutait encore autre chose : la personnalité, disait-il, se structure aussi par le récit que chacun construit pour se raconter lui-même et donner un sens à sa propre existence. Il concluait sur la souffrance de tous ceux qui se sentent exclus parce qu’ils n’ont pas de récit fondateur, ni la capacité ou la possibilité de formuler leur récit personnel.
Eh bien moi, j’estime que le rôle de la télévision, c’est le rôle des anciens aborigènes, c’est de raconter les histoires de la connaissance, c’est de donner du récit. Bien sûr, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bla-bla, de parasites qui ne sont pas du récit. Mais… quand on y songe : regardez le succès des émissions où on voit et où on écoute M. et Mme tout-le-monde nous raconter leur vie et leurs drames, regardez comment les « héros » de la télé-réalité sont anxieux de faire entendre leur récit. Regardez enfin comment les mêmes sont parfois furieux parce qu’ils sont dépossédés de leur histoire. Ils ont voulu exprimer leur vérité et l’émission terminée présente une personnalité qui n’est pas la leur, qui n’est plus leur récit.
Toutefois, les missions fondamentales de la télévision sont la transmission des œuvres magistrales du cinéma et de la chansonnette. Le petit écran en fait grand usage. Et là, vous le sentez bien, nous abordons véritablement les rivages de la culture et du récit, au sens traditionnel. Il y a des films classiques et des chansons à deux sous qui ont joué un rôle important dans ma vie et dans la façon dont je considère mon existence, et vous probablement la vôtre. Le savant philosophe dont je vous parlais tout à l’heure dirait que cela a structuré notre conscience de nous-mêmes.
Ceci n’est qu’un survol car je voudrais en venir à un domaine plus confidentiel mais que je connais mieux, du coté de la fabrication et… de la création (voilà un plus joli mot et j’espère qu’il correspond mieux à ce que j’essaie de faire dans mon métier). Ce sont les documentaires. Dans le procès qu’on intente régulièrement à la télévision en matière de culture, ils servent régulièrement d’alibi ou de dossier à charge.
La fiction a fait l’objet de beaucoup de critiques récemment, et chose intéressante d’ailleurs, de la part de ceux qui la fabriquent et qui reprochent à leurs commanditaires d’avoir mauvais goût et de leur couper les ailes. Ceux-ci répondent que les téléfilms coûtent cher et qu’ils doivent donc rapporter beaucoup d’argent en publicité, et de ce fait, satisfaire le plus grand nombre. Moralité : ils sont souvent « formatés » comme nous disons dans notre jargon, c’est-à-dire coulés dans le même moule. La dizaine de caractères que l’on voit régulièrement représentés à l’écran ont toujours les mêmes petits travers que l’on excuse, les mêmes gros défauts impardonnables, et les mêmes ennuis qui parfois… nous ennuient. Notre époque si prompte à donner des leçons d’anticonformisme aux époques précédentes devrait peut-être utiliser ce miroir pour se livrer à son autocritique.
Le documentaire, lui, est plus ou moins à l’abri du formatage parce que c’est le parent pauvre. Moins d’argent moins de publicité, des horaires plus difficiles… donc a priori moins de pression sur le réalisateur à qui on a laissé, par générosité ou par erreur, le droit de surprendre. D’autant qu’un documentaire offre moins de prise : il représente la réalité. Il est donc plus délicat de suggérer comme l’a fait un directeur de studio hollywoodien à un scénariste qui lui proposait une vie de Beethoven : « Il est passionnant ton Ludwig, mais est-ce obligatoire que le héros soit sourd ? »
Bien sûr, les documentaires véhiculent aussi des clichés, des banalités, mais comme nous sommes ici pour évoquer ce qu’ils font de mieux, disons le tout de suite : ils racontent des histoires de la connaissance. Comme Gulpilil. Ces histoires ne passent pas forcément par les mots du commentaire – il y a même des films sans commentaires –, elles passent par le choix des événements, leur traitement par l’image, leur enchaînement, leur confrontation. C’est ainsi que s’organise le récit. Mis à part le fait que la grammaire soit différente, c’est un travail qui s’apparente à celui d’un conteur. Il s’agit de savoir par où commencer l’histoire, par le début, par le milieu, par la fin. De choisir entre dévoiler l’essentiel tout de suite comme le fait un journaliste avant de développer les faits ou au contraire de jouer sur le suspense, l’intrigue ou de faire rêver. D’agencer les musiques et l’atmosphère.
Le vrai bonheur, à mon avis, c’est de chercher la forme de récit qui convient le mieux au sujet dont on parle. Et bien sûr de découvrir, de rencontrer et (disons le mot) de choisir des gens qui vous racontent des histoires. Car le documentaire conjugue souvent plusieurs récits : la narration qui est la trame du film, et puis les interventions des gens que l’on interviewe pour connaître leur part de vérité.
À ce propos, je tiens à souligner que j’appartiens au front de réhabilitation de l’anecdote injustement dénigrée par les beaux esprits qui emploient la formule « c’est anecdotique ». Quelle erreur ! Les anecdotes sont la quintessence du récit. À tel point que mes préférées sont les anecdotes en poupées russes dans lesquelles quelqu’un raconte une histoire que lui a racontée quelqu’un d’autre. Dans le meilleur des cas, cela vous donne un éclairage sur celui qui parle, sur la personne dont il parle et sur la nature de leurs relations.
Dans le film que j’ai réalisé sur Jaques Chardonne, il y a une anecdote de cette sorte. Elle est relatée par Christian Millau et elle est à double détente. Il ouvre un jour un livre que Chardonne venait de publier et dans lequel, à son habitude, celui-ci mêlait fiction et réalité, et il tombe sur des lignes consacrées à une jeune fille nommée Martine. Il arrive au bas de la page, la tourne et lit avec stupéfaction : « Elle est charmante il faudrait lui faire épouser Christian Millau… » Je n’arriverai pas à le raconter aussi bien que lui. Donc, je vous laisse imaginer son coup de fil à Chardonne et les excuses de celui-ci. Mais bref, le récit de Chardonne essayait de structurer au sens le plus fort, l’existence de Christian Millau, et quand Millau raconte l’anecdote, il reprend le contrôle du récit et il nous restitue la nature de leur amitié et une vision de la personnalité de Chardonne qu’aucune description ne pourrait approcher. Le plus rigolo d’ailleurs c’est que Millau a tout de même dîné avec la jeune Martine en question, cela n’a rien donné mais c’est la preuve que la prose de Chardonne avait beaucoup d’influence.
François Nourissier, dans le même film rapporte avec délectation une autre anecdote. Lorsqu’il était jeune homme, il avait confié à Chardonne qu’il était amoureux d’une Parisienne mais qu’il n’avait pas d’argent pour la rejoindre et Chardonne lui aurait dit : « Je vais écrire à Gaston Gallimard de vous trouver un travail, puisque nous sommes brouillés, je peux lui demander un service »… Le récit que Chardonne faisait de la situation dans sa lettre, son « puisque nous sommes brouillés, je peux vous demander un service » avait structuré la réalité d’une façon telle que Gaston Gallimard avait effectivement offert un emploi à Nourissier. Ce qui avait marché, et ce qui quarante ans plus tard faisait toujours la joie de Nourissier, c’était la formulation. La force des mots. Et par ailleurs, du moins je l’espère, cela donne envie de lire Chardonne dont les phrases ou le récit ont un si passionnant pouvoir sur l’existence.
J’ai longtemps pensé que je préférais faire des films sur des gens qui s’intéressent au récit, des écrivains, des acteurs, des aborigènes, des musiciens aussi parce que la musique est une forme de récit. Je l’ai longtemps pensé et je le pense encore mais je sais maintenant que le vrai plaisir est dans la rencontre, l’aventure dans le temps ou dans l’espace. La magie du récit est toujours là, le jeu c’est de la découvrir pour qu’elle puisse vous enchanter.
Et je l’ai appris de la plus jolie façon qui soit ; je reçois un jour un coup de fil d’un producteur me disant : «J’ai beaucoup aimé votre série sur les acteurs, je voudrais vous demander un film ». C’est le genre de phrase qui va droit au cœur d’une réalisatrice. Fort bien, lui dis-je. Quel est le sujet ? Sa réponse, j’en suis sûre, va beaucoup plaire à votre assemblée car il me proposait un documentaire sur les huîtres. J’étais sidérée. Comment mes portraits d’acteurs où la parole jouait un rôle prépondérant avaient-ils pu lui faire penser que j’étais la femme de la situation ? Les huîtres, vous le savez mieux que quiconque sont des animaux extrêmement attachants, c’est même leur qualité la plus reconnue, mais très peu doués pour le récit : on vante davantage leur mutisme. Sur le moment, c’est le défi sans doute, qui m’a attirée. J’ai glané tous les récits des ostréiculteurs qui connaissent les secrets de la mer, les récits des scientifiques qui se passionnent pour la sexualité des huîtres, ceux des historiens qui découvrent des amateurs d’huîtres dès les origines de la civilisation… et je me suis régalée à réaliser ce film que j’ai appelé bien entendu Histoires d’huîtres !
Et mon Charentais ? Il s’appelle Clément Lafaille, vous le connaissez… au moins de nom. Car il a surtout fréquenté vos arrière-grands-parents. Il a créé au XVIIIe siècle, le somptueux cabinet de curiosités qui est à l’origine du Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle. Il y avait rassemblé d’extraordinaires coquillages qui faisaient sa fierté. C’était aussi un très bon dessinateur et il a réalisé des aquarelles remarquables, les premières peut-être à représenter le travail des ostréiculteurs. Mais il avait une collection encore plus étonnante, il ramassait tous les cailloux dont les veines ou les irrégularités semblent dessiner une lettre, un V, un H, un C, etc.
Car Clément Lafaille était un disciple des encyclopédistes : il espérait retrouver dans ces pierres, les signes d’un alphabet imprimé par un être suprême qui lui permettraient de lire dans le grand livre de la nature. La science ne l’a guère suivi sur cette voie.
Cette histoire de cailloux m’a beaucoup émue et je me suis débrouillée pour la caser dans le film. Et puis, je me suis demandée pourquoi elle me plaisait tant. Je crois que Clément Lafaille cherchait à donner un sens aux choses, et pour le trouver, il pensait qu’il lui fallait découvrir un récit. Un récit précieux, une histoire de la connaissance. Il cherchait dans ses cailloux ce que, sans doute, nous essayons de trouver avec nos images. Et je me sens très proche de ce monsieur-là.