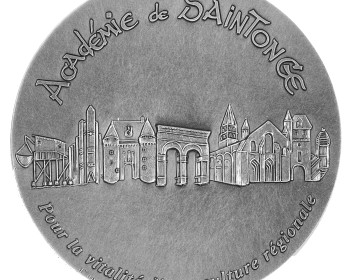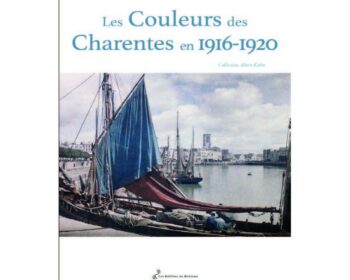Georges Bonnet pour l’ensemble de son oeuvre littéraire
 Rapport d’Alain Quella Villéger
Rapport d’Alain Quella Villéger
Georges Bonnet est un Saintongeais de Poitiers qui, depuis juin dernier, a dans cette ville une rue qui porte son nom. Ce n’est pas banal. L’homme ne l’est pas. Fils de paysans originaires d’Aigrefeuille installés près de Pons (un lieudit au nom pittoresque : Tartifume), mis au monde en 1919 par le gendre d’Emile Combes, il a vu Goulebenèze en spectacle, ici même à Saintes. Georges Bonnet garde le souvenir d’une enfance malheureuse et solitaire, mais riche de regard, d’écoute, d’imaginaire et, paradoxalement, de paradis perdu : « En ce temps-là, j’habitais encore les yeux de la mère » (Un seul moment, 2004). D’où des titres qui annoncent finalement de l’ensoleillement : Un si bel été (Flammarion, 2000, Prix du Livre en Poitou-Charentes 2000), Un bref moment de bonheur (Flammarion, 2004). Les plus récents sont un recueil de prose poétique, Lointains (Océanes, 2005), un roman, Les Yeux des chiens ont toujours soif (Le Temps qu’il fait, 2006), et un recueil de poèmes, Un ciel à hauteur d’homme (L’Escampette, 2006) ; un éditeur oléronnais, un autre à Cognac, le troisième à Chauvigny, bel exemple d’équilibre régional !
Certificat en poche, il vient au collège de Saintes (n’insistons pas : mauvais souvenirs d’internat et de piètre cantine), puis rejoint en Corrèze son frère aîné, instituteur à Tulle, pour quelques années lycéennes et le bac. Il voulait être footballeur, il est devenu professeur d’Education physique (en 1945), fixé à Poitiers à partir de 1954 jusqu’à sa retraite en 1979. Il fut un lecteur peu précoce, et attendit d’être octogénaire pour nous livrer des romans. Entre temps, des ébauches d’adolescent aux recueils publiés (une quinzaine ; le premier : en 1965), il fut poète. Il a aimé Cadou l’homme de Loire, Aragon le Parisien, Malrieu l’Occitan, a connu Guillevic le Breton, fut l’ami de Daniel Reynaud le Charentais, mais a écrit sans esprit de territoire, de chapelle. Sans gratuité, non plus : « quand j’écris les mots me regardent » (Un ciel à hauteur d’homme), rappelle-t-il.
Cinquante ans passés à Poitiers ne remplacent pas une enfance saintongeaise, dit-il ; elle est là « encore tiède », racontée de l’extérieur comme par dédoublement. La chronique autobiographique se nourrit d’un altruisme attentif ; les mots « pèsent leur juste poids », ils ont une sorte de volatilité et pourtant sont choisis au gramme près, avec ce qu’il faut d’humidité dans l’air et de lumière. La lenteur des jours, l’éphémère, ces « moments » qu’on trouve par deux fois dans ses titres (« bref », aussi), sont sauvés avec une minutie d’oiseau au rebord d’une fenêtre. Des textes qui ont une beauté et une tendresse telles qu’on voudrait les apprendre par cœur – je veux dire, bien sûr, par le cœur. Je terminerai sur un souvenir, lorsque le jeune Georges Bonnet arrive au collège de Saintes, il prend conscience de son nom (« il n’avait jusqu’alors entendu prononcer que son prénom ») et des inégalités sociales. Scène de récréation : « Le fils d’un riche commerçant partage un citron sous le préau, offre un quartier à ceux qui l’entourent, lui tend la peau, à lui, le fils de paysans. Blessé, il ressent une violente amertume. » Ce prix que nous lui remettons, aujourd’hui, est un citron tout entier.
« Le temps revenait chaque année d’éclaircir les betteraves à peine nées, en des sillons interminables. A genoux sur la terre, d’un coup d’œil il fallait déceler la plus vigoureuse et arracher entre pouce et index les indésirables. J’ai appris là l’essentiel de l’écriture. »