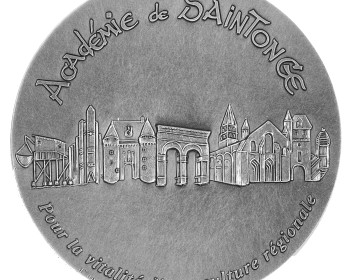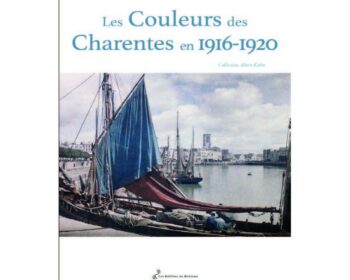Réception de Jacques Bouineau
 1er siège, quatrième titulaire.
1er siège, quatrième titulaire.
Professeur de droit à l’université de La Rochelle et romancier, originaire de Royan, prix Chasseloup-Laubat 1986 pour sa thèse Les toges du pouvoir ou la révolution de droit antique.
Réception par Violaine Massenet
Jacques Bouineau est né à Saintes mais sa vie s’enracine à Rétaud, et même s’il est rattaché à l’île d’Oléron par son père, il reste cet enfant ébloui par la seule lumière, émerveillé par la simplicité secrète de l’art roman. Entre ombre et rayonnement, ouverture et mystère, Jacques Bouineau est d’abord un pur Saintongeais.
Cet homme que nous accueillons était promis depuis toujours à occuper un siège dans notre Académie tant ses mérites sont éclatants. Il suffisait qu’il se décidât à occuper la place qui lui était due. C’est chose faite aujourd’hui. Mais qui recevons-nous vraiment ? Le juriste, l’historien, le romancier, l’aventurier ? Qui se cache derrière cette ferme douceur ? Quel feu couve sous cette voix au timbre si maîtrisé? Quelles passions animent cet homme courtois et qui semble s’être accompli selon ses désirs ? Je n’ai pas la prétention ni d’ailleurs l’envie de découvrir au-delà des apparences le vrai visage de Jacques Bouineau, visage qui, au fond, ne regarde que lui. Ce qu’il nous donne à voir, à lire, à entendre me suffit, nous suffit.
Jacques est venu au droit par la parole. Etre juriste pour lui c’est d’abord entrer dans un discours puis dans une pensée enfin dans un regard. Loin d’être un ensemble de normes, le droit est un à ses yeux parcours effectué aux confins de la sociologie de l’histoire et de l’ethnologie. Juriste extraordinaire, au sens fort du terme, Jacques commence pour faire plaisir à son père par passer le concours d’Inspecteur des Postes puis, une fois ce pieux devoir accompli, il s’inscrit à la Faculté de Bordeaux où il se passionne pour la science criminelle (il rédige un mémoire sur les perversions sexuelles), pour la grammaire historique, l’analyse logique, la paléographie et, accessoirement, pour l’histoire du droit. Il se rend en cours les cheveux longs, un sac Leclerc à la main. Il passe pour communiste, anarchiste. En tout cas, il est sûrement poète. Il est décalé, brillant, insaisissable. Semblable à Alain-Fournier, auteur qu’il vénère, il résiste à la médiocrité et au conservatisme.
Mais le droit ne ne comble pas son intense curiosité pour le monde. Il s’inscrit en 3ème année d’Histoire à la Faculté de Lettres, travaille à sa thèse d’Etat « Les réminiscences de l’Antiquité sous la Révolution française » et à sa thèse de 3ème cycle en Histoire sur « Les Beaumont, seigneurs de Bressuire ». Dans ces travaux, il allie rigueur et passion et remporte tous les succès, dont un prix de l’Académie de Saintonge pour sa thèse d’Etat publiée conjointement par les éditions Eché et par l’Université de Toulouse. Mais l’Université se méfie des météores et la profondeur, l’exigence, l’intelligence sans concessions de Jacques ne lui valent pas que des amis. C’est donc de haute lutte qu’il remporte un poste d’assistant à Montpellier, faculté où il ne connaît personne. L’agrégation est la prochaine étape. Il s’y présente deux fois, est d’emblée admissible, d’emblée écarté. Trop brillant, trop original. Son deuxième échec à l’agrégation le plonge dans le désarroi. Puis c’est l’exil à Rennes où il est nommé maître de conférences. Il s’y ennuie, s’évade en Grèce où il découvre, par l’intermédiaire du trésor de Philippe de Macédoine, le père d’Alexandre le Grand, à la fois l’éclat légendaire de cette mer nourricière qu’est la Méditerranée et sa propre vérité qui a à voir avec ce soleil forgé en même temps d’or et d’ombre.
Dès lors, sa vie va changer. Il devient professeur d’Histoire des idées politiques à Saint-Cyr où les étudiants réputés pour être les plus exigeants de France lui font un triomphe. A Nanterre où il est nommé parallèlement, son originalité est aussitôt appréciée. Il y crée la revue « Méditerranées » qui bénéficiera pendant plus de dix ans d’une vaste audience. Il se présente pour la troisième fois à l’agrégation où il est enfin brillamment reçu. Il enseigne avec passion, rayonne de colloques en colloques de la Tunisie à Malte, de la Grèce à la Sardaigne, tout en restant fidèle à ses étudiants de Saint-Cyr.
Un jour, heureusement pour nous, il choisit de retourner en Saintonge. La Rochelle lui ouvre ses portes. Il lui restera fidèle. Et durant deux ans passés en poste au Caire comme directeur de l’Institut de droit des affaires où il apprend l’arabe et découvre le monde musulman, il continue à gracieusement à donner des cours de doctorat sur le thème délicat des « fondements romano canoniques de la responsabilité ». Cependant, ces travaux érudits ne l’occupent pas tout entier. En effet, depuis l’âge de treize ans, Jacques écrit et, durant ses rares loisirs d’universitaire reconnu, le prurit de la création le reprend. Avec son ami d’enfance, Didier Colus, il publie aux Editions du Cerf deux romans historiques : « Les Chemins de Jérusalem » en 1999 et « Les Poulains du royaume » en 2001. Ses personnages voués à une quête initiatique évoluent entre l’histoire et l’intime. Leurs élans, leurs doutes, leurs combats, leurs questions sont ceux de l’écrivain. En effet, Jacques a suivi très tôt l’injonction de Socrate « Connais-toi toi-même ! » Il a appris à reconnaître ses limites mais aussi à suivre ses élans. Il fait du réel une aventure intérieure, il explore et affronte son imaginaire par le biais de cette épopée des Croisades qui va compter encore plusieurs volumes. Il travaille aussi avec ferveur à des œuvres très personnelles, romans et nouvelles, qui ne tarderont sûrement pas à voir le jour et à éclairer pour ses lecteurs son univers onirique si particulier, réductible à aucun autre.
Pendant des années, Jacques Bouineau n’a habité nulle part, ne donnant pour adresse qu’une boîte postale, ne livrant à la société qu’une errance. Puis il a consenti à occuper un lieu, « La chambre des ouvriers » dans sa maison d’enfance à Rétaud. Aujourd’hui, c’est la maison mère toute entière qu’il habite autant qu’il en est habité.
En prononçant l’éloge de cet homme pudique et secret, en l’accueillant aujourd’hui, il me semble que je reconnais l’évidence de sa présence parmi nous. Quand il a appris son élection, Jacques m’a confié qu’il avait pensé au tableau du Caravage « La Vocation de Saint Mathieu » : Quelqu’un vous tend la main et dit : « Suis-moi ». Cette distinction s’apparente pour lui à ces signes étranges dont toute vie authentique est jalonnée. Bien loin d’être un symbole élitiste, son entrée à l’Académie revêt à ses yeux le sens d’un appel et aussi d’un devoir. Servir et non pas se servir. Aller de l’avant tout en étant fidèle à ses sources. Redevenir cet enfant de Rétaud, fasciné par le clair obscur de l’église de son village, ébloui par la lumière mystérieuse des vitraux.
J’allais oublier : Jacques est un hôte facile à recevoir. Il peut dormir partout, sur les bancs publics chers à Georges Brassens, au bord des fossés, sur les toits de stations météo, dans des friches industrielles et au coeur des forêts des contes de fées.
Nous n’aurons donc aucun mal à lui faire ici la place qu’il mérite et d’où il pourra veiller, avec l’acuité de ses talents, sur le destin de notre province inspirée.
Saintongeais de droit romain par Jacques Bouineau
Madame la Directrice, chers Collègues, Mesdames et Messieurs,
La tribune d’où je vous parle aujourd’hui m’a accueilli, vous le savez, sans que j’aie rien fait pour m’en approcher. C’est pourquoi je voudrais commencer ce discours en vous remerciant de m’avoir appelé à siéger parmi vous. Etymologiquement, l’appel est une vocation et je songe à ce superbe tableau du Caravage représentant la Vocation de saint Matthieu. La vocation est une grâce, mais elle est aussi une dette, celle de savoir s’acquitter de l’appel dont on est l’objet, celle d’assumer les obligations nées de la place que l’on occupe, celle d’être digne de l’honneur qui vous est fait.
Car cet adoubement me fait poser une question : suis-je digne de lui ? Les premières fois où je suis allé travailler à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, alors que je m’asseyais dans un de ces grands fauteuils de bois, devant ces tables culottées, je me demandais combien de postérieurs augustes avaient écrasé les cannages où je posais le mien. J’étais fier et intimidé. Je souhaitais ardemment ressembler à tous ceux qui avaient réfléchi dans ces lieux et j’espérais qu’un peu de leur science allait sourdre des pupitres, que je pourrais m’incorporer un de ces suppléments d’âme qu’ils avaient peut-être oublié en allant reprendre leur chapeau.
Vous m’avez élu au premier fauteuil de votre Académie, à la succession de M. Tessonneau.
Rémy Tessonneau naît à Jarnac-Champagne et passe lui aussi par les facultés de lettres et de droit de Poitiers et de Paris. Mais il s’oriente plutôt du côté de celles-là que de celui-ci, puisqu’il est en définitive docteur ès-lettres et licencié en droit. Il suit ensuite une double carrière d’administrateur civil et d’écrivain. Son caractère est déjà formé ; il l’a été entre les murs sombres de Recouvrance à Saintes, où il apprit à ne pas laisser aller ses sentiments, à adopter un abord impavide, cachant une grande richesse intérieure, une profonde sensibilité.
Comme administrateur civil, il est d’abord durant quelques mois sous-préfet, directeur de cabinet du commissaire de la République à Lille en 1944-1945. On le retrouve ensuite secrétaire général des Mines domaniales de Potasse d’Alsace, puis de la Société d’Etudes Chimiques pour l’Industrie et l’Agriculture (SECPIA), et enfin directeur général de l’Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC), où il reste presque vingt ans, jusqu’à l’âge de 59 ans ; c’est au cours de cette période qu’il fonde le Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision.
Là se trouve le moment fort de sa carrière professionnelle, là il donnera toute sa mesure. Son action se déploie au niveau international. Il est partout : au Japon, en Irak, au Pérou, mais au Cambodge aussi, où il est fait Commandeur de l’ordre royal du Shamétréi, ou en Italie, tout simplement, où on lui remet la médaille du Mérite. Souvent missionné par les Affaires culturelles, il prononce plusieurs conférences, rencontre ses homologues des pays d’accueil et, lui qui y était si attaché, fait rayonner la culture française.
Mais Rémy Tessonneau est aussi en contact avec les étudiants, à Nanterre d’abord, où il fonde le Centre d’études générales audiovisuelles. La vie au milieu des étudiants est un allant de soi chez cet homme pour qui administrer ne veut pas simplement dire gérer, mais aussi encadrer, guider, conseiller. On le trouve encore en poste à 69 ans, tenant toujours ouverte la porte de son bureau.
Nanterre, ses brumes, ses révolutions et ses bidonvilles laissent la place aux universités de Nice et Créteil, où il professe peu, mais dirige le département audio-visuel. La retraite n’interrompt pas ses activités, n’entame pas son dynamisme. En 1977, il est président-fondateur, puis président d’honneur de l’université francophone d’été Saintonge-Québec d’ethnologie audiovisuelle, sise à Jonzac au cloître des Carmes. A 75 ans, il accomplit sa dernière création : celle de la Société des amis de Joseph Joubert. Car Rémy Tessonneau a beaucoup d’affinités avec Joseph Joubert, né deux siècles avant moi et mort à l’âge où lui prenait sa retraite, à qui il a consacré sa thèse et plusieurs ouvrages par la suite.
Mais le professeur Tessonneau est aussi écrivain, témoin de son temps et quenaille saintongeais, décoré à plusieurs reprises, lauréat de l’Académie française et de l’Académie de Saintonge naturellement, prix Broquette-Gonin et Maujean, grand prix du romantisme pour l’ensemble de son œuvre, et membre de la Société Chateaubriand. .
On retiendra de lui l’harmonie solide entre l’homme de cœur et l’homme de décision, le Saintongeais profondément attaché à sa terre et le défenseur de la civilisation française, qui n’hésitait pas à écrire en frontispice d’un de ses ouvrages : « Je dédie ce livre aux esprits assez révolutionnaires pour sauver les traditions de la haute qualité française ». Mais c’était aussi un homme vivant, entreprenant de nombreux voyages, en Traction Citroën d’abord, en DS ensuite, dont celui-ci où une défaillance inopportune de la Traction contraignit le couple d’aventuriers à prendre le bateau suivant pour Patras, dans des conditions déjà spartiates puisqu’il fallut combattre la punaise, ennemie perfide et insistante du voyageur d’alors.
En me voyant ici succéder à ce professeur, écrivain et administrateur civil, je ne peux m’empêcher de songer à un de nos grands historiens du droit qui, s’il avait, comme Jacques Brejon de Lavergnée, vécu après la création de l’Académie de Saintonge, y aurait été évidemment comme lui et comme moi accueilli, je veux parler d’Adhémar Esmein, le célèbre historien du droit du début du XXe siècle. La postérité dira ce qu’il faut penser de ce que j’aurai écrit, mais je puis vous assurer que dans tous mes travaux scientifiques, à Paris ou au Caire, à la ressemblance de ce qu’a fait Adhémar Esmein avant moi, je n’ai jamais cessé de proclamer ma fierté d’être né à Saintes et de compter deux tiers d’ancêtres saintongeais, et ce depuis la nuit des temps.
Jhe seus sensément né natif de cheus nous.
Et de fait, cette terre se retrouve aussi dans plusieurs de mes romans, publiés ou non. Elle constitue, entre Didier, qui a si souvent tenu la plume avec moi, et moi, un de ces traits d’union improbables, lui que je raille régulièrement d’être un métèque italo-breton, bien qu’il soit tout de même Saintongeais pour tout un quart de son sang.
Qu’a-t-elle donc cette terre que bien des ignorants ne savent pas où situer sur une carte, pour m’enraciner si solidement ? Suis-je sensible à sa lumière qui n’a d’équivalent qu’en Galilée et que le peintre Félix Cavel, l’ami de ma grand-mère, poursuivait au cœur de ses tableaux ? Comment me nourrit-elle cette terre, pour que je puisse écrire ? Comment est-ce que j’écris et que veut dire écrire ?
La question est présomptueuse tant le sujet a été rebattu. Si je prétends faire un peu de neuf sur ce thème fort ancien, il me faut rappeler la Saintonge et n’oublier jamais qu’elle est en toile de fond. Il me faut considérer mes limites et les dettes que j’ai contractées au long d’un parcours de presque 6000 pages imprimées et de quelques milliers encore qui le seront peut-être un jour, inch Allah, comme on le dit dans mon autre chez moi.
Ecrire, c’est d’abord proposer des modèles. Ces mots que je viens de tracer sont un acte de foi et je les assume comme tels. A l’heure où la mode est de parler un peu plus de soi que ce ne fut par le passé, il est de bon ton de se donner en pâture et de s’arrêter longuement sur ses interrogations du moment. Regard horizontal. Reflet démultiplié à l’infini de complaisances quotidiennes. Construction en abîme.
Est-ce parce que je suis d’un pays plat – la Saintonge n’est guère montueuse – que j’ai refusé cet angle d’observation, depuis que j’ai quitté les premières heures du scripteur amateur ? Est-ce parce que j’écris en français, que nous écrivons, Didier et moi en français, et que lui, le fils d’immigrés affectionne tant cette langue que sa tribu adopta naguère ? Est-ce parce que je crois que la littérature doit aussi instruire, que j’ai privilégié le regard vertical ? Celui qui oblige à sortir de soi-même, à regarder non seulement devant, mais plus haut, vers des cieux ou un monde idéal, vers Platon ou saint Thomas, en regrettant de ne pouvoir écrire comme Flaubert.
Car l’écriture est semblable à l’aliment. Elle nourrit le cœur et l’intelligence de celui qui y touche. Faut-il être niais pour croire que c’est en contemplant des images abâtardies de soi-même, mais de même nature, que l’on va pouvoir trouver un bâton pour cheminer. Faut-il être vaniteux pour oser comparer ce que l’esprit humain a conçu de plus beau, de plus haut, de plus noble, aux narrations ancillaires des agitations quotidiennes. Faut-il être démuni pour ne pas voir que les grands modèles de l’esprit nous tendent la main et n’attendent que notre bon vouloir pour nous approcher d’eux.
J’ignore à tout jamais la portée de ce que j’écris. Entre les haines recuites, les aveuglements de l’amitié et les opportunismes de rencontre, je ne pourrai pas plus que quiconque jamais savoir à quel niveau se situe ma production. Et c’est tant mieux ! Me placerait-on trop bas que j’en serais paralysé, me hisserait-on trop haut que j’en serais tétanisé et incrédule, me cantonnerait-on dans le marais que je m’y noierais. Et d’ailleurs, pour parler en juriste, je pense que je
n’ai à satisfaire à aucune obligation de résultat, mais à m’acquitter seulement d’une obligation de moyens par la maîtrise chaque jour un peu plus affinée d’un savoir-faire auquel je prends grand soin de m’appliquer.
Mais écrire, c’est aussi s’offrir. Parler de soi en somme, alors que je m’en défendais naguère ? Renoncer à épouser les nuances infinies des aquarelles saintongeaises, pour se livrer à la facilité et à la satisfaction de soi ? Certes non. Mais quand votre vocation vous a fait naître double, quand par un fatum étrange la gémellité est venue s’en mêler, il faut bien convenir que chaque mot écrit s’apparente à un fragment d’ADN porté par la déhiscence. Les choses sont ainsi faites que j’écris principalement pour l’Université, c’est-à-dire avant tout pour mes étudiants. Je leur offre ce que mes raisonnements théoriques peuvent avoir d’original, tout ce que je ne peux pas leur expliquer en cours. Ils ne saisissent que le Verbe d’une persona, passé au filtre de la réflexion. Mais même s’ils ne voient de moi que l’intellect, la sensibilité ne peut jamais être véritablement absente, notamment parce qu’ils savent que je les aime.
La sensibilité possède à l’inverse la première place dans Jérusalem ou Les poulains, comme nous disons dans l’intimité. Là, jaillit la foi, l’amour, la volonté de partage. Cette écriture ne peut rien décrire d’autre que la misère commune partagée par tous, sans jamais perdre de vue que les raisons d’espérer ne sont pas devant, mais plus haut. Nous l’avons appris ensemble, lui et moi, mon double en écriture, en compagnie de qui j’ai découvert tant de choses de la vie depuis bientôt un demi-siècle que, tels Erckmann et Chatrian, tels Boileau et Narcejac, qui fut membre de cette académie, nous cheminons de conserve. Comme nous ne savons plus très bien qui de nous a pensé ou écrit, quand nous écrivons ensemble, nous avons toujours, jusque-là, publié à quatre mains et je ne sais pas si je pourrais un jour, sans me sentir hémiplégique, faire seul le chemin de cette offrande aux autres avec les manuscrits qui sont dans mes tiroirs.
Ce que l’on offre, ce que nous offrons, ce que j’offre, qu’il s’agisse de l’Université ou de la littérature est à chaque fois complet, absolutus, délié de toute entrave, où chaque page n’est qu’un élément, un pagus où la Saintonge possède toujours un rôle, où l’entier de moi se retrouve dans chaque part, si vous m’autorisez à parodier Victor Hugo. Tout n’est question que de proportion, dosage de mots qui dissimulent cette page blanche qu’est la nudité de l’être.
C’est donc tout le contraire de l’exhibitionnisme au goût du jour. L’écrit possède à mes yeux une fonction plus qu’un but : servir ceux qui, via la main tendue des mots, puiseront le suc dont ils feront leur miel. L’écriture est un aliment, cuisiné avec discernement, que l’on offre dans un plat adapté à ses convives, qui sont sa raison d’exister.
Ecrire, c’est servir.
Celui que vous avez choisi se considère donc comme un débiteur. Débiteur vis-à-vis de vous-mêmes, qui l’avez élu, débiteur envers sa terre à laquelle il se trouve viscéralement attaché, débiteur envers ceux qui le supportent depuis si longtemps. Celui qui vous parle, bien conscient du poids de ses dettes, les assume toutes et se propose de les honorer.